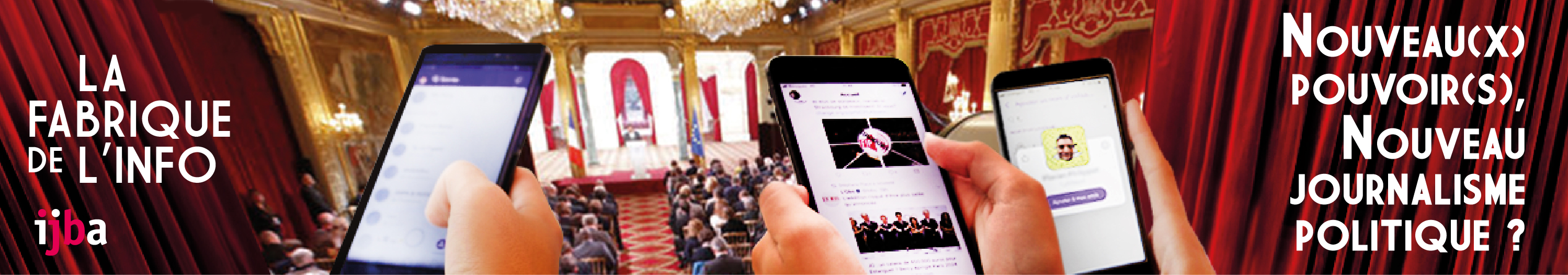Six ans après la révolution, exercer le métier de journaliste en Tunisie reste difficile. Censure, auto-censure et retards administratifs pèsent sur la profession. Être un journaliste indépendant est en soi un acte politique.
4 avril 2016. Dans les locaux de la rédaction de web-magazine Inkyfada, c’est l’effervescence. Le pure-player indépendant est le partenaire tunisien du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui coordonne le gigantesque travail autour des Panama papers. 11,5 millions de fichiers épluchés par plus de 370 journalistes mettent à jour un vaste système d’évasion fiscale. Sana Sbouai et Malek Khadraoui, les fondateurs du site, s’apprêtent à publier plusieurs révélations sur des personnalités tunisiennes.
La première enquête charge Mohsen Marzouk, le directeur de campagne de l’actuel président tunisien élu en 2014. Ce membre fondateur de Nidda Tounes, parti politique progressiste, est soupçonné d’avoir pris contact avec le cabinet Mossack Fonseca dans le but de « constituer une société off-shore aux Îles Vierges ou à Anguilla ». Les journalistes joignent à leur enquête, les mails et devis qui attestent de ces échanges.
L’article est publié à 22h, à 0h24 Inkyfada est victime d’une cyber-attaque d’une « rare violence » raconte Monia Ben Hamadi, l’actuelle rédactrice en chef. L’attaque provient de plusieurs adresses IP, le site est rapidement mis hors-service. Les pirates « injectent du contenu mensonger » : ils remplacent le nom et le visage de Mohsen Marzouk par celui du principal opposant politique du président de la République. « Il faut savoir que nous collaborons avec de très bons développeurs, pour certains d’anciens cyber-activistes. Nous avons été débordés par cette attaque ».
Le site est rendu indisponible pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, les journaux mainstream et les médias nationaux invitent Mohsen Mazourk à se défendre. Jugeant ces affirmations « diffamatoire » L’opinion publique était clairement en notre défaveur, mais cela nous a également apporté des soutiens supplémentaires d’activistes ou de citoyens et une certaine visibilité à l’internationale, se rappelle la rédactrice en chef. C’était une attaque éminemment politique. Nous avons reçu des menaces de la part d’autres médias, des intimidations. Certains ont réalisé des caméras cachées dans nos locaux. »
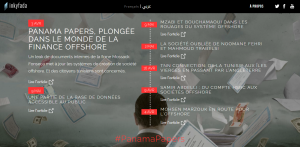
Inkyda n’est pas seul, Yasmine Kacha, responsable du bureau Afrique du Nord de Reporters sans Frontières prend position et dénonce « cette cyber-attaque qui démontre combien le journalisme d’investigation fait encore peur en Tunisie. » Et d’affirmer que « le pays a plus que jamais besoin de ces publications courageuses. » Pour ce qui est des auteurs de l’attaque, rien ne permet de vérifier leur identité. Monia Ben Hamadi reste persuadé que les pirates étaient des proches de Mohsen Marzouk. Aujourd’hui une instruction a été ouverte au pôle financier du Tribunal de première instance. « Sans porter l’espoir d’aboutir à des coupables. »
L’avant / après révolution
À la veille de la Révolution de 2011, une telle agression n’aurait pas eu cours, tout simplement parce qu’un média libre comme Inkyfada n’aurait jamais pu voir le jour. Pour Monia Ben Hamadi, « la situation actuelle de la presse n’a rien à voir avec l’avant Révolution ». La liberté d’expression et l’ouverture du secteur de la presse sont parmi les principaux acquis de la Révolution, même si un certain flou juridique persiste sur le statut d’Internet et la légalité de la censure.
Le pure-player, nouvel outil de liberté
Face à l’écueil de la précarité, les médias indépendants tentent de diversifier leurs modèles économiques. Pour s’assurer une totale liberté, Inkyfada a choisi un statut associatif, l’association Al Khatt est la structure légale du média. Ce sont les prestations de services cette association : éducation à l’information dans les écoles, développement de sites web, ainsi que des bailleurs de fonds qui financent le média. « Aujourd’hui nous atteignons un équilibre à 70 % de prestations de services et 30 % de bailleurs de fond. Nous souhaitons les limiter pour plus de crédibilité et d’indépendance. »
Les pure-players qui veulent aussi diversifier leurs contenus mêlent production audiovisuelle et multimédia, formations, aide internationale, financement participatif, fourniture de contenus à des médias nationaux et étrangers, services de fixing… Historiquement, la libération de la parole est venue de Facebook et plus généralement d’Internet. Les médias en ligne bénéficient donc d’une légitimité historique.
Le contenu internet est de toute façon plus difficile à censurer. Les journalistes et développeurs web créent actuellement une solution Cms qui permettra aux journalistes d’intégrer du contenu enrichi dans les articles, de manière plus simple, sans avoir recours à des développeurs. Dans son rapport publié en 2015, l’Agence française de la coopération des médias dénombre 180 pure-players en Tunisie dont beaucoup de webradios.
Les lois de l’ère Ben Ali restent en théorie applicables. Les décrets-lois 115 et 116 signés en novembre 2011 apportent des gages aux défenseurs de la liberté d’expression, tout comme les articles 30 et 31 de la Constitution. L’Agence tunisienne de l’internet (ATI), qui jusqu’en 2011 organisait la censure du réseau, a maintenant pour principale mission la promotion du web auprès des Tunisiens, et son PDG a déclaré : « Aujourd’hui, aucun site n’est bloqué, aucun site n’est censuré. »
Rien n’est moins sûr, tous les journalistes rencontrés au cour de cette enquête s’accordent à dire que les progrès sont là, mais qu’on est bien loin d’une liberté entière et totale. Mohammed Haddad, journaliste indépendant et correspondant en Tunisie pour des médias étrangers, raconte combien il est difficile d’exercer son métier sereinement. Il pointe à la fois la censure, l’auto-censure et l’inertie administrative du pays.
Certaines lignes rouges se sont dessinées ex-nihilo. Réaliser une interview dans un café à proximité de bâtiments ou de ministères publics est devenu plus compliqué aujourd’hui qu’au lendemain de la révolution. Il n’est pas rare que des agents demandent des autorisations, comme si l’administration cherchait à faire un copier-coller de leur propre discipline. Sauf que nous sommes des journalistes.»
Mohammed Haddad raconte qu’après l’attentat de Berlin au marché de Noël en 2016, tous les médias internationaux et nationaux se sont rendus dans le village natal du terroriste présumé, dans une région rurale du centre de la Tunisie. Le journaliste travaille alors pour l’agence de presse britannique Reuters. Il reste bloqué durant quatre heures au poste de police, le temps que l’autorisation du premier ministère qui lui avait été envoyée sur son mail personnel soit transmise au chef de la police par fax.
« Ces protocoles n’ont parfois pas de source légale. Ils traduisent un excès de zèle, une incompréhension voire une suspicion envers les journalistes. »
Ces pressions administratives, plus difficiles à détecter et à dénoncer, n’en sont que plus efficaces.
Un autre signe qui ne trompe pas pour Mohammed : la présidence de la République ne reçoit plus aucun journaliste depuis 2014 et l’élection de Béji Caïd Essebi. « Le palais de Carthage était en quelque sorte mystifié, inaccessible, source de peurs et d’injustices avant la Révolution. Il a été ouvert en 2011. Avec l’actuel président les portes se sont refermées. » Dans les faits, quand le Président reçoit des personnalités étrangères ou organise des événements, la communication se contente d’une société de production privée pour les images et propose ensuite un montage aux médias. Monia Ben Hamadi appuie la réalité de cette censure. « Le délit de diffamation est encore en vigueur. Les journalistes risquent encore des peines de prison pour diffamation ou insultes, délits de presse. »
La rédactrice en chef du pure-player dénonce l’utilisation dévoyée d’une justice militaire qui poursuit encore des blogueurs ou citoyens qui s’expriment sur des réseaux sociaux. « Cette justice ne s’applique constitutionnellement qu’à des délits militaires et ne devrait pas concerner les journalistes. Cette justice d’exception est encore employée contre la liberté d’expression pour empêcher toute critique de l’armée. » Yasmine Kacha confirme cette insécurité : « des exactions continuent à être commises par des policiers contre des journalistes lors de manifestations. »
En septembre 2017, Hamdi Souissi journaliste pour Diwan FM, couvrait une manifestation lorsqu’il a été pris à parti par un groupe de policiers. Le rapport de RSF signale que le reporter a été « blessé au visage et à l’épaule » et qu’il a subit un « interrogatoire de police et la saisie de son matériel. » Les journalistes ont la possibilité de déposer plainte, mais c’est un « véritable parcours du combattant et souvent les journalistes préfèrent abandonner face à la difficulté. » Aujourd’hui une seule journaliste persiste à poursuivre ses agresseurs, la justice n’a pas encore tranché.
La tentation de l’auto-censure
Olivier Piot, journaliste français, auteur de La Révolution tunisienne, 10 jours qui ébranlèrent le monde arabe est en charge du programme de formation et d’échange Médias et démocratie, dont le point d’ancrage est à Tunis. Le projet a été créé d’un pan à l’autre de la Méditerranée. L’idée est d’aider les journalistes africains à réfléchir sur leur métier, l’éthique, la mutation de la profession, pour que les médias dont ils font partie puissent jouer leur rôle dans les transitions démocratiques. « Nous avons choisi la Tunisie, car selon nous c’est le pays où la transition démocratique est la mieux engagée et la plus durable. »
Les participants, étudiants et journalistes tunisiens sont également formés à l’utilisation des réseaux sociaux, aux relations avec les lanceurs d’alertes, etc. « Sortir d’une dictature et mettre en place de nouvelles institutions relève d’un long processus. Le pluralisme politique est plutôt acquis en Tunisie mais aujourd’hui c’est une transition éonomique dont le pays a besoin. » Inévitablement, la question du modèle économique des médias et du statut de ses journalistes se pose. La précarité va de pair avec le métier.
Beaucoup de journalistes sont mal payés, parfois au black. Le salaire moyen est de 658 dinars, il se situe ainsi dans la fourchette basse des revenus moyen d’un Tunisien. (entre 600 et 900 Dt, autour de 300-450 €). Ils peuvent perdre leur travail du jour au lendemain. Une telle insécurité est incompatible avec une liberté de la presse. Selon Mohammed Haddad,« le choix de la facilité, de la parlote ne peut pas être seulement résolu par une formation. La question est : est-ce qu’on a le moyen de s’affranchir ou pas. »
Retour historique : la révolution de jasmin dans les médias
Selon l’Étude sur le développement des médias en Tunisie publiée par l’Unesco en 2012, sous Ben Ali, la majorité des médias tunisiens suivent la ligne gouvernementale et l’agenda présidentiel. Censure oblige, les journalistes étrangers ne peuvent pénétrer sur le territoire. Face à l’absence de couverture par les médias nationaux, la lutte pour le droit à l’information et à sa diffusion s’organise progressivement sur internet. Les autorités surveillent alors les réseaux sociaux et bloquent certains accès avec l’aide de la police qui filtre directement au niveau des fournisseurs d’accès.
Quelques médias indépendants sont tolérés pour simuler un droit démocratique, mais ils sont observés de près. Ceux qui osent la critique s’exposent à la répression, aux licenciements ou aux incarcérations. Beaucoup abandonnent la résistance. La loi sur la presse de l’époque prévoit des peines de prisons de plusieurs années notamment pour la diffamation des membres du gouvernement. En 2010, à la veille de la Révolution, la Tunisie se situe au 164e rang dans la liste de la liberté de la presse établie par RSF, soit parmi les quinze derniers États du monde.
Après l’immolation par le feu du marchand de légumes Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, les premières protestations voient le jour dans la région, elles vont s’étendre à toute la Tunisie et conduire à la révolution du 14 janvier 2011. A l’époque, les médias de masse n’évoquent pas l’événement. La propagation se fait via Twitter et Facebook, grâce à des témoignages appuyés par des photos et de vidéos. Le 13 janvier 2011, le président Ben Ali promet dans une allocution télévisée, la liberté de la presse et l’assouplissement de la censure. Cela ne suffit pas à calmer les manifestants. Le dictateur quitte le pays.
Après sa fuite, un gouvernement de transition est formé. Il annonce la levée de la censure et le rétablissement total de la liberté d’expression et de presse. Pourtant, quelques sites web restent bloqués. Pour mieux observer les restrictions RSF ouvre en octobre 2011 un bureau à Tunis. Dans une lettre ouverte au gouvernement tunisien, l’organisation se plaint, un an après la révolution, de répressions croissantes contre les journalistes. L’ONG rend aussi publique une série d’atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d’opinion et des attaques contre des journalistes.